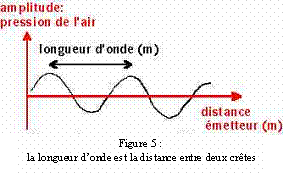Depuis toujours nous vivons entourés de son, le son n’existant que pour ceux qui peuvent l’entendre puisque que c’est le cerveau qui donne naissance au son, sur indication de l’oreille. On notera toutefois que les personnes atteintes de surdité ne peuvent peut-être pas entendre la musique, mais elles sont capables de la « ressentir » grâce à d’autres organes. Nous nous intéressons ici à la forme classique de la perception du son : grâce à l’oreille.
L’oreille est un récepteur qui capte les ondes mécaniques de type acoustique, produites par un émetteur quelconque. D’après sa définition, le son est une sensation auditive engendrée par une onde acoustique, dont il existe deux formes : « les variations de pression périodiques », et les autres, ces dernières étant appelées familièrement « bruit » car le mot son désigne aussi toute variation se propageant dans l’air et qui est capable d’impressionner notre oreille.
En physique, nous avons étudié les propriétés du son : pour les physiciens c’est une onde progressive mécanique périodique de type acoustique, une onde qui est de plus tridimensionnelle et longitudinale.
Nous allons expliquer les termes de cette phrase :
Onde : une onde correspond à une perturbation de la matière par transfert d’énergie, mais sans que la matière ne soit elle-même transportée. Pour le son, cette énergie transportée est la pression que l’on exerce sur un certain milieu (gazeux, liquide ou solide), pression qui est à l’origine du son. On sait également que les ondes mécaniques peuvent se croiser, on peut ainsi entendre une personne en face de nous tandis que d’autres personnes parlent autour de nous
Progressive : ce terme indique simplement que l’onde se déplace dans l’espace, elle est ainsi opposée aux ondes stationnaires
Mécanique : il s’agit ici de la définition du type de perturbation de la matière que provoque cette onde (on parle aussi d’onde matérielle). Le son est une onde et est donc à l’origine de mouvements mécaniques de l’air
Périodique : cette caractéristique de l’onde sonore permet de l’opposer au bruit, qui n’est pas « organisé » comme l’est le son.
A l’aide d’un micro, nous transformons la pression reçue en tension. Sur les deux graphiques suivants nous présentons les variations de la tension en fonction du temps.
Sur le premier graphique, la tension varie de manière régulière : l’onde est périodique, et nous sommes donc en présence d’un son.
Sur le second graphique, la tension est chaotique et n’observe aucune périodicité : nous sommes en présence d’un bruit
tridimensionnelle : l’onde sonore se propage en effet dans toutes les directions de l’espace.
Longitudinale : une onde peut être soit transversale soit longitudinale. Elle est dite longitudinale pour indiquer que la matière est perturbée de façon parallèle.
Sur cette figure 3 on peut voir que le son est une onde longitudinale.
La vitesse du son dépend de l’élasticité et de la densité du milieu dans lequel il évolue : plus le milieu est dense, moins il est élastique et plus le son se propage rapidement car les atomes sont plus proches et ils se rencontrent dans un intervalle de temps plus court, propageant ainsi plus rapidement le mouvement de la matière provoqué par l’onde sonore.
Le graphique suivant nous donne un ordre de grandeur de la vitesse de propagation du son dans différents matériaux.
On observe que le son va plus vite dans les liquides que dans les gaz, et encore plus vite dans les solides, qui sont eux-mêmes plus denses que les liquides.
Lorsque l’on représente l’amplitude du signal (la pression exercée sur l’air) en fonction de la distance à l’émetteur, la longueur d’onde en mètre est la distance parcourue pendant une oscillation complète (distance entre deux crêtes du signal)
La fréquence, qui s’exprime en Hertz (Hz) correspond au nombre d’oscillations complètes effectuées par l’onde en une seconde. Plus la fréquence d’un son est élevée, plus le son est aigu. Ainsi les sons graves sont ceux dont la fréquence est inférieure à 20 Hz, les sons médiums ceux dont la fréquence est comprise entre 500 et 3000 Hz et les sons aigus ceux dont la fréquence est supérieure à 3000 Hz.
Le son est produit à partir de vibrations mécaniques naturelles (corde vocale) ou artificielles (corde de guitare, membrane d’une enceinte).
Pour vérifier que les vibrations sont mécaniques nous pouvons faire l'expérience suivante.
Nous avons placé un réveil (en train de sonner) dans une cloche à vide. Au début nous entendions parfaitement le son produit par notre réveil. Mais lorsque nous avons commencé à retirer l’air contenu dans la cloche grâce à une « pompe », le son se faisait de plus en plus inaudible. Nous pouvons donc en conclure que le son ne se propage pas dans le vide.
Effectivement, le son a besoin de matière, plus particulièrement de particules, pour se propager.
Nous pourrons donc étudier la fréquence, la vitesse, la période, la longueur d’onde et l’origine des sons.
Nous avons ainsi défini le son, mais il nous faut un récepteur pour l’entendre et le capter. L’oreille humaine en est un.